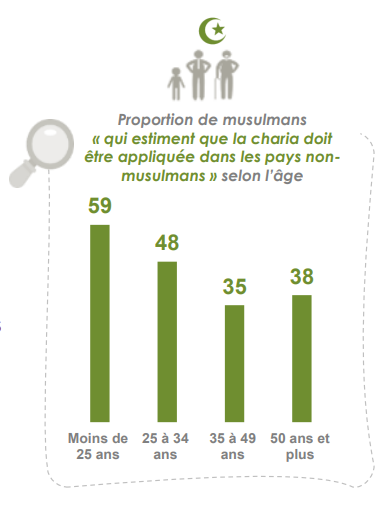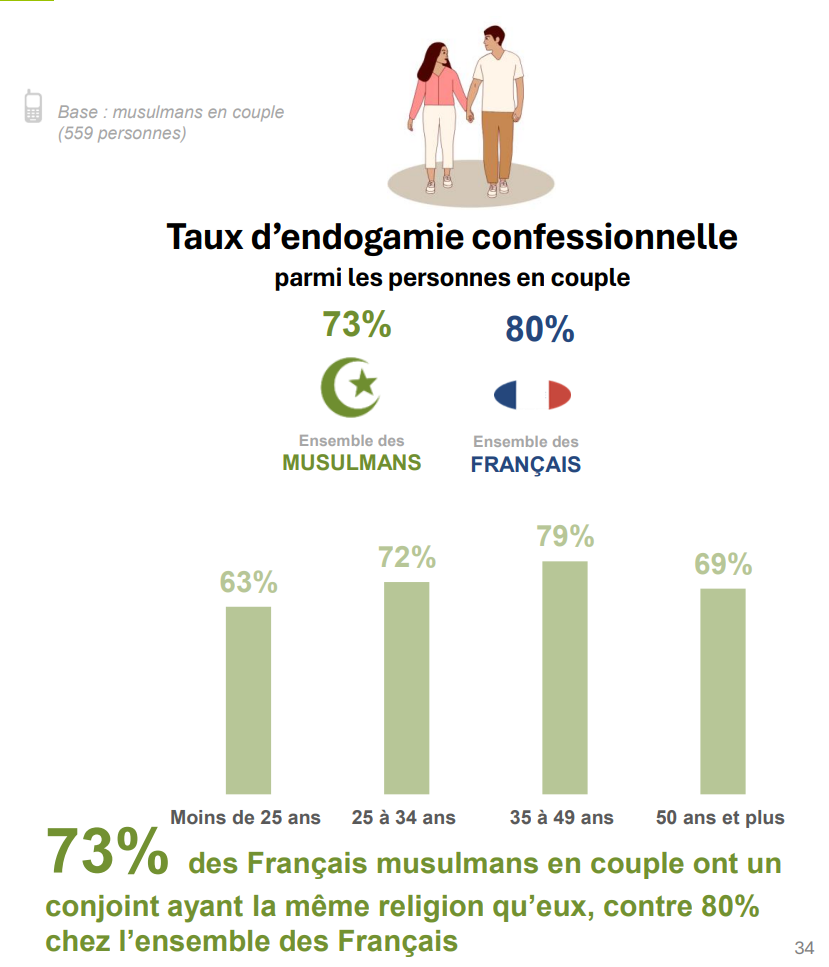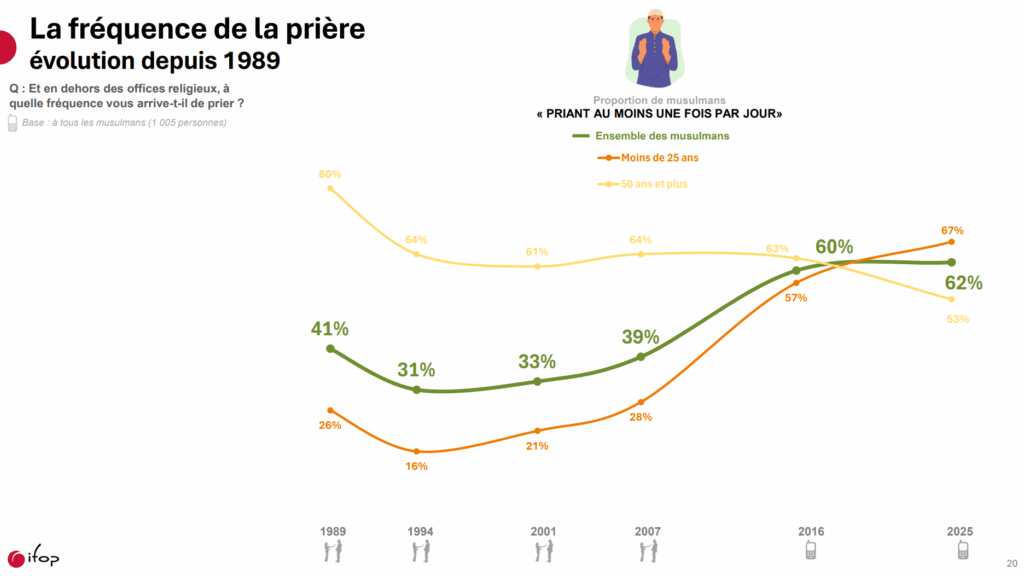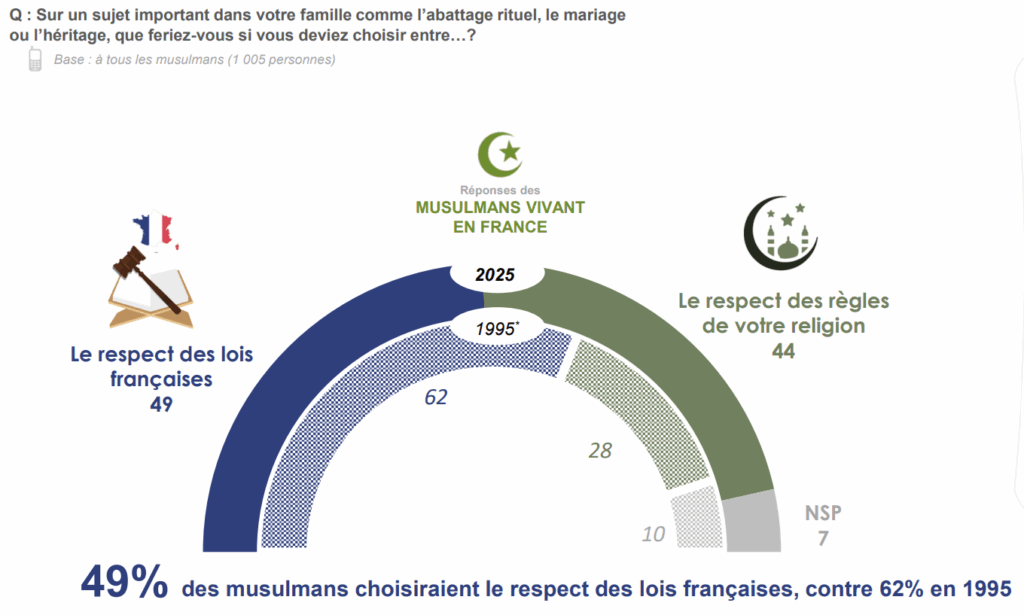La loi du 9 décembre 1905 fête ses 120 ans avec des commémorations officielles à l’Assemblée nationale, au ministère de l’Intérieur et dans l’ensemble des services publics. Née pour pacifier une France déchirée par les conflits politico-religieux, elle institue un État neutre qui garantit la liberté de conscience de chacun sans privilégier aucun culte. Dans un monde de réseaux sociaux, d’influenceurs prosélytes, de tensions autour du voile et de recompositions spirituelles, ce principe fondamental est mis à l’épreuve.
Cet article propose un bilan philosophique de la laïcité, examine ses défis concrets, que ce soit à l’école, en ligne, dans les consciences et interroge son avenir en plaçant au cœur la liberté individuelle et le vivre-ensemble, loin des caricatures.
De 1905 à 2025 : la promesse de l’émancipation
La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État repose sur deux articles fondateurs qui structurent encore aujourd’hui le cadre républicain français. L’article 1 proclame la liberté de conscience et l’égalité de tous devant la loi, indépendamment des croyances ou convictions. L’article 2 stipule que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Rapportée par Aristide Briand, cette loi met fin au régime concordataire napoléonien sur la majeure partie du territoire, transfère la propriété des biens d’Église aux communes et encadre la création d’associations cultuelles, dans le respect de l’ordre public.
À l’occasion de ses 120 ans, l’État organise expositions historiques, journées thématiques au ministère de l’Intérieur, ressources pédagogiques renforcées via Eduscol pour les établissements scolaires, et une journée nationale de la laïcité solennellement observée dans les services publics. Ces initiatives rappellent que la loi de 1905 n’est pas un simple texte juridique poussiéreux, mais le « cœur du pacte républicain », comme le soulignent les communications officielles.
Philosophiquement, la laïcité naît comme un projet d’émancipation rationnelle et individuelle, héritier direct des Lumières. Elle libère l’individu de toute tutelle religieuse imposée par l’État ou par des institutions dominantes, permettant à chacun de croire librement, de ne pas croire, de changer de croyance, ou même d’en combiner plusieurs, sans discrimination ni pression publique. Dans la France de 1905, marquée par l’affaire Dreyfus, les querelles scolaires entre républicains et cléricaux, et des décennies de tensions politico-religieuses, cette loi agit comme un contrat de paix civile : l’État renonce à trancher le vrai en matière de salut éternel pour se concentrer sur le droit commun, la justice sociale et l’intérêt général.
Cent vingt ans plus tard, le paysage religieux et spirituel s’est profondément métamorphosé. Les enquêtes d’opinion les plus récentes montrent qu’environ 37% des Français se déclarent sans religion organisée, que la pratique catholique régulière a chuté à moins de 10% de la population (contre plus de 20% dans les années 1960), que l’islam s’affirme comme la deuxième religion de France avec environ 5 à 6 millions de fidèles estimés, et que les spiritualités alternatives (méditation, ésotérisme, syncrétismes personnels) gagnent du terrain chez les jeunes générations. La laïcité ne gère plus seulement la relation entre un État et une Église catholique historiquement dominante ; elle arbitre un pluralisme mouvant et individualisé, où coexistent athées militants, agnostiques, croyants pratiquants de diverses confessions, et explorateurs de spiritualités hybrides.
Cette émancipation promise par 1905 reste pourtant inachevée sur un point crucial : si l’emprise institutionnelle des Églises a reculé, d’autres formes de pouvoir se sont insinuées dans les consciences collectives. Marchés financiers dictant les priorités économiques nationales, algorithmes publicitaires des géants du numérique façonnant les désirs et les opinions, lobbys technologiques et pharmaceutiques influençant les politiques publiques : ces « tutelles laïques » conditionnent les choix individuels sans débat démocratique équivalent à celui qui prévalait contre les cléricaux. La laïcité protège admirablement la liberté de conscience contre les dogmes religieux, mais elle peine encore à s’affirmer pleinement face à ces influences non religieuses, pourtant tout aussi puissantes et souvent plus insidieuses.
C’est dans la vie quotidienne en société que cette promesse prend tout son sens. Le vivre-ensemble laïque n’est pas un slogan abstrait : c’est le droit concret pour un musulman pratiquant, un athée convaincu, un juif orthodoxe, un chrétien évangélique ou un adepte de yoga philosophique de coexister sans que l’un impose sa vision aux autres. Chacun est libre dans sa sphère privée ; la loi commune régit l’espace public partagé. La laïcité n’impose pas l’athéisme ni une uniformité des pensées ; elle protège précisément la diversité des choix individuels contre toute domination.
Laïcité et liberté vestimentaire : un équilibre fragile
Le port du voile islamique, des kipas juives ou d’autres signes religieux visibles cristallise depuis des décennies les débats sur la laïcité, car il met en tension directe la liberté individuelle d’expression et la neutralité exigée dans certains espaces publics. Dès 1989, le Conseil d’État statue que le voile peut être toléré à l’école comme signe religieux discret, à condition qu’il ne trouble pas l’ordre public ni ne constitue un acte de prosélytisme. La circulaire Bayrou de 1994 tente de préciser ces conditions, mais c’est la loi du 15 mars 2004, votée à une large majorité sous Jacques Chirac, qui marque un tournant en interdisant les signes religieux « ostensibles » dans les écoles, collèges et lycées publics : voile couvrant les cheveux, grandes croix, kippa voyante, bandana explicitement religieux. En 2013, la charte de la laïcité affichée dans tous les établissements réaffirme explicitement ce cadre afin de préserver la neutralité pédagogique et de protéger les élèves des pressions communautaires.
Les données empiriques sur les effets de cette loi sont contrastées mais instructives. Une étude menée notamment par l’économiste Éric Maurin montre que la loi de 2004 a eu un impact positif sur les trajectoires scolaires d’un certain nombre de jeunes filles issues de l’immigration : augmentation des taux de réussite au baccalauréat et poursuite plus fréquente des études supérieures, corrélée à une moindre pression vestimentaire dans l’environnement scolaire. D’autres travaux soulignent, à l’inverse, des effets d’exclusion pour les élèves qui refusent d’ôter leur voile, avec un risque de déscolarisation ou de repli communautaire. Plus récemment, le Conseil d’État a validé en 2023 l’interdiction des abayas et qamis dans les établissements scolaires, considérant qu’ils constituaient, dans le contexte français, des signes religieux ostensibles, après une hausse marquée des signalements de la part des rectorats.
Les chiffres récents du ministère de l’Éducation nationale illustrent la sensibilité de ce sujet. En 2024, 1 848 signalements d’atteintes à la laïcité ont été enregistrés, contre près de 3 900 en 2023, année marquée par un contexte international très tendu. Une part importante de ces faits concerne les tenues (abayas, qamis), des signes religieux visibles ou des contestations liées à des cours jugés contraires à des convictions religieuses, par exemple sur l’évolution biologique ou l’égalité femmes-hommes. Les collèges publics concentrent environ la moitié de ces incidents, confirmant que c’est à l’adolescence que se jouent les rapports les plus conflictuels entre affirmation identitaire, normes familiales et cadre laïque de l’école.
Dans ce cadre, la laïcité ne nie pas la liberté de porter le voile dans l’espace public : une femme adulte peut librement se voiler dans la rue, dans de nombreuses entreprises privées ou dans sa vie personnelle, dès lors que la loi commune est respectée. En revanche, la neutralité s’impose dans certains espaces et certaines fonctions : salle de classe, bureaux de vote, tribunaux, guichets administratifs, où les agents du service public doivent apparaître comme indépendants de toute confession. Ce n’est pas la conviction intime qui est visée, mais l’affichage ostensif d’appartenance religieuse là où la puissance publique est en jeu. L’objectif est double : protéger les usagers contre toute pression, et garantir la confiance de tous dans l’impartialité de l’institution.
Autrement dit, la laïcité protège deux libertés en tension sans les opposer. D’un côté, la liberté pour chacun de se vêtir, de croire, de pratiquer, de manifester ses convictions dans la sphère sociale ; de l’autre, la liberté des autres de ne pas être soumis à des pressions symboliques ou communautaires dans des espaces qui doivent rester communs à tous. Le vivre-ensemble suppose cette réciprocité : ma liberté d’expression religieuse s’arrête là où commence la liberté d’autrui d’être accueilli comme égal, sans assignation religieuse ni injonction implicite. C’est dans cet équilibre concret, parfois fragile, souvent conflictuel, que la laïcité continue de se jouer, chaque jour, dans les établissements scolaires et les services publics.
Prosélytisme numérique : le nouveau champ de bataille
Un phénomène nouveau concentre aujourd’hui les inquiétudes des autorités : l’essor des influenceurs religieux 2.0, musulmans comme chrétiens, qui utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des messages de foi, mais aussi des normes très prescriptives, sans toujours distinguer témoignage personnel et pression doctrinale. Des enquêtes de presse et des notes issues du ministère de l’Intérieur décrivent une « galaxie de prêcheurs numériques » : imams, prédicateurs, influenceuses voilées, mais aussi figures chrétiennes, parfaitement à l’aise avec les codes de TikTok, Instagram ou YouTube. Leurs contenus mêlent courts rappels religieux, conseils de vie quotidienne, motivation spirituelle, humour et critiques plus ou moins explicites de la société occidentale et de la laïcité.
Dans le cas de certains influenceurs musulmans, ces formats servent de vecteur à des visions rigoristes de l’islam, parfois inspirées de courants salafistes. Des rapports pointent la manière dont ces comptes « phagocytent » TikTok, en multipliant des vidéos très virales de prières simplifiées, de « fatwas lifestyle » sur la tenue, la sexualité, la mixité, ou encore la contestation de la laïcité présentée comme une oppression structurelle des musulmans. La note d’un rapport commandé par le ministère de l’Intérieur parle d’un « pool d’influenceurs et d’influenceuses islamistes autoproclamés, générant de très fortes audiences, véhiculant sur TikTok des expressions ultra-rigoristes et bâtissant des communautés significatives », avec des commentaires de followers pouvant appeler à la haine ou au séparatisme.
Mais le phénomène ne se limite pas à l’islam. Du côté chrétien, le nombre d’influenceurs francophones a fortement augmenté en quelques années, avec des dizaines, voire des centaines de comptes actifs sur Instagram, TikTok et YouTube. Ces créateurs mêlent évangélisation, témoignages de conversion, versets bibliques, musique, développement personnel et contenus « lifestyle » (couple, travail, argent). Un reportage diffusé en 2025 sur « le grand boom des influenceurs chrétiens » souligne l’ampleur de ces audiences et leur impact missionnaire, notamment sur les jeunes adultes, en lien avec une hausse de démarches spirituelles et de baptêmes d’adultes.
Du point de vue de la laïcité, le problème n’est pas l’existence de ces contenus en tant que tels : la liberté d’expression et de religion implique le droit de parler de foi en ligne, de témoigner, d’annoncer un message spirituel. Ce qui devient problématique, c’est la combinaison de plusieurs éléments : un discours très normatif sur la conduite à tenir (tenue vestimentaire, relations, rapport au corps), une mise en scène séduisante empruntant au marketing d’influence, et une tendance à présenter la norme religieuse comme supérieure à la loi commune ou au cadre laïque. L’école et les services publics se retrouvent alors attaqués comme des lieux de « corruption morale » ou de « dévoiement de la foi », ce qui peut inciter certains jeunes à contester frontalement les règles de neutralité ou certains enseignements.
Les autorités éducatives constatent des répercussions directes : contestation de cours de SVT ou d’histoire sur la base de vidéos virales, refus de certaines activités mixtes inspirés de prédications en ligne, ou adoption de tenues issues de codes promus par ces influenceurs. En 2023–2024, une part non négligeable des près de 2 000 atteintes annuelles à la laïcité recensées dans les établissements est liée, directement ou indirectement, à des contenus circulant sur les réseaux sociaux. La laïcité apparaît alors comme un cadre de protection indispensable, non seulement pour garantir la neutralité du service public, mais aussi pour préserver la liberté de conscience des élèves qui ne souhaitent pas se conformer à ces normes religieuses, sans subir de pression ou de harcèlement.
À côté de ces courants religieux plus classiques, la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) alerte sur l’essor d’autres formes de prosélytisme, tout aussi préoccupantes : groupes sectaires, gourous du « bien-être », mouvements crudivoristes et New Age. Le rapport d’activité 2022–2024 fait état d’une hausse importante des signalements de dérives sectaires, passés de quelques milliers à plus de 4 000 par an, avec un glissement vers les domaines de la santé, du bien-être et du développement personnel. Les pratiques de jeûne extrême, de crudivorisme intégral ou de pseudo-thérapies promettant des guérisons miraculeuses tout en incitant à abandonner les traitements médicaux sont particulièrement mises en cause.
Des cas documentés montrent comment certains « coachs » crudivoristes ou « thérapeutes spirituels » exercent une emprise psychologique et financière sur leurs adeptes, allant jusqu’à contrôler leur alimentation, leurs relations et leurs choix de vie, avec parfois des conséquences graves pour la santé. D’autres mouvements, issus du New Age, combinent croyances en les énergies, astrologie, réincarnation, discours complotistes et promesses d’« éveil » à travers des stages ou retraites très coûteux. Une enquête relayée par Marianne souligne que les classes moyennes et supérieures, persuadées d’être protégées par leur niveau d’éducation, se montrent en réalité particulièrement vulnérables à ces offres de développement personnel à risque.
Dans tous ces cas (influenceurs musulmans ou chrétiens, sectes, crudivoristes, new age) un point commun apparaît : l’emprise sur les consciences. L’objectif n’est plus simplement de proposer une vision du monde, mais de créer une dépendance, de verrouiller le doute, de culpabiliser ceux qui s’éloignent, et parfois de les couper de leur entourage ou des institutions. La laïcité, telle que pensée en 1905, protège d’abord contre la domination d’une Église sur l’État ; en 2025, elle doit aussi être comprise comme une protection de la liberté de conscience contre toutes les formes d’emprise, qu’elles soient religieuses, pseudo-thérapeutiques ou spirituelles alternatives. Elle ne vise pas à interdire la recherche de sens, mais à garantir que cette recherche reste un choix, et non le résultat d’une captation ou d’un conditionnement.
Réseaux sociaux : la laïcité, carburant de clash et frein au vrai vivre-ensemble
Les réseaux sociaux ont transformé la laïcité en objet permanent de polémique, où un principe pensé pour apaiser devient souvent prétexte à indignation, buzz et affrontements symboliques. Des vidéos d’élèves contestant un cours au nom de leur foi, d’enseignants filmés à leur insu ou de sanctions disciplinaires présentées comme « islamophobes » ou « antireligieuses » circulent massivement, souvent hors de tout contexte. Dans le même temps, des comptes ultra-laïques ou identitaires utilisent la moindre affaire de voile, d’abaya ou de prière pour dénoncer une prétendue « invasion religieuse », réduisant la laïcité à une arme contre certaines minorités. Les algorithmes, qui favorisent les contenus les plus polarisants, amplifient ce phénomène : plus un contenu choque ou divise, plus il est mis en avant, ce qui enferme chacun dans des bulles où la nuance disparaît.
L’école se trouve en première ligne de ce choc permanent. Des enseignants témoignent de situations où des élèves arrivent en classe avec des arguments « prêts à l’emploi », tirés de vidéos d’influenceurs ou de fragments de débats télévisés, pour refuser un chapitre sur l’évolution, contester un cours d’éducation affective ou rejeter un rappel à la neutralité vestimentaire. Inversement, certains professeurs font l’objet de campagnes de dénigrement en ligne, sur la base d’extraits tronqués ou de rumeurs, ce qui fragilise leur autorité et leur sécurité. Dans ce contexte, la laïcité est parfois perçue par les élèves non comme une garantie de protection pour tous, mais comme un dispositif hostile relayé par des adultes « contre eux ». Pour éviter que la laïcité ne devienne un simple carburant de clash, il faut la réinscrire dans une culture du débat argumenté : expliquer patiemment les règles, distinguer les espaces (école, réseaux, sphère privée) et rappeler que le but n’est ni de faire taire les croyances ni de les imposer, mais de permettre à chacun de coexister sans pression.
Face à ces dérives, plusieurs pistes se dégagent. D’abord, l’éducation aux médias et à l’information doit devenir un axe central de la pédagogie laïque : apprendre à analyser une vidéo virale, à repérer les manipulations, à distinguer un témoignage d’un appel à la haine, fait partie intégrante de la défense de la liberté de conscience. Ensuite, il est nécessaire de soutenir les équipes éducatives par des cellules de veille, des formations et des procédures claires lorsque des conflits nés en ligne débordent dans l’établissement. Enfin, il importe de produire d’autres récits : des contenus positifs, portés par des enseignants, des élèves et des citoyens, qui montrent une laïcité vécue comme un cadre d’apaisement, de liberté partagée et de respect mutuel, plutôt que comme un champ de bataille permanent.
Vers l’avenir : laïcité face aux IA, spiritualités émergentes et bioéthique
La laïcité des prochaines décennies devra affronter des défis qu’Aristide Briand n’aurait pas imaginés : montée de l’intelligence artificielle comme nouvel horizon de croyances, explosion des spiritualités hybrides et recomposition permanente des débats bioéthiques. L’enjeu reste pourtant le même qu’en 1905 : protéger la liberté de conscience, éviter que la loi commune ne soit capturée par un dogme, qu’il soit religieux, idéologique ou technologique et garantir que chacun puisse chercher sa propre voie sans subir d’emprise.
Du côté de l’intelligence artificielle, les premiers signes sont déjà visibles : assistants conversationnels « religieux », applications qui personnalisent des lectures de textes sacrés, projets de robots capables de réciter des prières ou d’accompagner des rituels. Derrière l’outil technique se dessinent des questions très concrètes : que se passe-t-il si un algorithme, conçu par une organisation religieuse ou idéologique, devient la principale source de réponses pour des milliers de fidèles ? Comment éviter que des systèmes techniques ne soient présentés comme neutres alors qu’ils véhiculent une doctrine particulière ? La laïcité, dans ce contexte, ne consiste pas à interdire l’usage religieux de l’IA, mais à rappeler deux lignes rouges : pas de confusion entre service public et outil confessionnel, et pas de croyance imposée par des technologies perçues comme infaillibles. Un État laïque ne délègue ni la morale, ni la loi, ni l’éducation à des machines qui porteraient une vision particulière du monde.
Parallèlement, le paysage spirituel se fragmente et se diversifie. La baisse de la pratique religieuse traditionnelle ne signifie pas la disparition de la quête de sens : au contraire, de nouvelles formes de spiritualités émergent, souvent à la carte. Éco-spiritualités centrées sur la nature, rituels néo-païens, syncrétismes mêlant méditation, astrologie et développement personnel, chamanisme urbain, pratiques d’« énergie » ou de « guérison vibratoire » : tout cela témoigne d’une volonté de réenchanter le monde en dehors des cadres institutionnels. La laïcité n’a pas vocation à juger de la vérité de ces démarches. Elle acte simplement que l’État reste neutre et que ces pratiques, comme les religions classiques, doivent respecter le droit commun, en particulier lorsqu’elles touchent à la santé, aux mineurs ou à la vulnérabilité psychologique.
Les questions bioéthiques, PMA, fin de vie, greffes, génétique, usage de l’IA en santé, sont un autre champ où la laïcité joue un rôle crucial. Les traditions religieuses y proposent des repères, parfois opposés entre elles ; les sciences y apportent des possibilités techniques toujours plus étendues ; les individus, enfin, se trouvent confrontés à des décisions intimes lourdes de conséquences. La laïcité garantit que la loi ne découle pas d’un dogme révélé mais d’une délibération démocratique, pluraliste, éclairée par les savoirs disponibles. Elle permet aux convictions religieuses ou philosophiques de s’exprimer dans le débat, mais empêche qu’une seule d’entre elles s’impose comme norme obligatoire pour tous. En parallèle, elle protège les consciences individuelles : clause de conscience pour les soignants, droit des patients à refuser ou accepter certains actes, possibilité d’arbitrer en fonction de ses propres repères sans se voir imposer ceux d’un groupe.
Dans ce contexte mouvant, la laïcité apparaît moins comme un héritage figé que comme une méthode pour affronter l’inconnu. Face à des IA présentées comme infaillibles, elle rappelle que nul ne peut s’ériger en autorité absolue, ni humain ni machine. Face aux spiritualités émergentes, elle reconnaît la légitimité des quêtes individuelles tout en refusant les emprises et les sectarismes. Face aux dilemmes bioéthiques, elle offre un cadre dans lequel croyants, agnostiques et athées peuvent discuter à égalité, sans que le dernier mot revienne à une Église, à un marché ou à une technologie. C’est dans cette capacité d’adaptation à des objets nouveaux, tout en restant fidèle à un noyau simple : neutralité de l’État, liberté de conscience, primat de la loi commune que se joueront les 120 prochaines années de la laïcité.
Pour une laïcité protectrice : liberté, choix et vigilance
À ses 120 ans, la laïcité n’est ni un vestige muséal ni une arme de guerre culturelle, mais un principe vivant qui doit se réinventer pour protéger les consciences face aux emprises du XXIe siècle. Trois impératifs s’imposent pour la rendre efficace et désirable : pédagogie, vigilance et culture du débat.
1. Une pédagogie renouvelée et accessible. Les chartes affichées et les parcours civiques actuels peinent face à la viralité des réseaux sociaux. Il faut produire des contenus courts, percutants, adaptés aux codes numériques : vidéos expliquant en 60 secondes « Pourquoi pas de voile en classe ? Parce que ton choix personnel ne doit pas peser sur le choix de ton camarade». Des exemples concrets doivent illustrer la laïcité vécue : droit absolu de changer de religion ou de conviction, interdiction formelle du prosélytisme à l’école, possibilité de critiquer une doctrine sans risquer d’insultes ou de menaces. L’objectif est de rendre la laïcité intelligible et désirable, non comme une contrainte abstraite, mais comme une garantie concrète de liberté pour tous.
2. Une vigilance renforcée sans laxisme. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1 848 atteintes à la laïcité en 2024 dans les écoles, influenceurs religieux totalisant des millions d’abonnés, signalements de dérives sectaires en hausse de plus de 100% selon la Miviludes. Réponses nécessaires : éducation aux médias obligatoire dès la 6e, cellules d’appui renforcées pour les enseignants confrontés à des conflits nés en ligne, régulation des plateformes pour plus de transparence sur les algorithmes et étiquetage des contenus prosélytes ou sectaires. La laïcité doit devenir un bouclier actif contre les marchés de l’emprise, religieux, bien-être ou technologique, tout en respectant scrupuleusement la liberté d’expression.
3. Une culture du débat argumenté. Fini les clashes stériles sur les réseaux sociaux ; place aux ateliers pluralistes où croyants, athées et agnostiques confrontent leurs visions sur le voile, l’évolution, la PMA ou la fin de vie, sans insulte ni délation. Un musulman pratiquant, une juive orthodoxe, un chrétien évangélique, un adepte de méditation ou un athée convaincu peuvent coexister pleinement si la loi commune est respectée. Le vivre-ensemble repose sur cette réciprocité simple : mon choix s’arrête là où la pression sur autrui commence.
La loi de 1905 n’est pas obsolète : elle fournit un cadre adaptable aux défis de demain, des spiritualités émergentes et de la bioéthique. Elle protège les consciences souveraines contre les religions prosélytes, les techno-dogmes et les gourous du bien-être. Pour le siècle qui vient, réinventons-la non comme punition, mais comme liberté gardée : un espace où chaque citoyen, croyant ou non, trouve sa place dans le respect, l’égalité et la paix civile.
La laïcité n’est ni une guerre de saints ni une complaisance coupable. C’est la promesse d’une émancipation où la diversité des consciences s’épanouit librement, sous la seule autorité de la loi commune.
Pour aller plus loin
Textes de loi et institutions
- Loi du 9 décembre 1905 – Séparation des Églises et de l’État (Legifrance)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749 - Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000417119 - Dossier “Séparation des Églises et de l’État” – Assemblée nationale
https://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/separation_eglises_etat.asp - La laïcité à l’école – Ministère de l’Éducation nationale
https://www.education.gouv.fr/la-laicite-a-l-ecole-1225 - Rapports et ressources sur la laïcité – Ministère de l’Intérieur
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Laicite - Bioéthique – Code de la santé publique (Legifrance)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072665
Données religieuses et paysage spirituel
- Religion et laïcité en France – Ifop
https://www.ifop.com/topics/religion-et-laicite/ - Religious Landscape – Pew Research Center
https://www.pewresearch.org/religion/
Laïcité à l’école, chiffres et rapports
- Bilan 2024 des atteintes à la laïcité à l’école – Ministère de l’Éducation nationale
(Page générale, à adapter selon la mise à jour la plus récente)
https://www.education.gouv.fr - Bilans de l’action des équipes “Valeurs de la République”
https://www.education.gouv.fr/bilans-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-republique-377756 - Article – “1 848 atteintes à la laïcité à l’école entre septembre et décembre 2024” (Europe 1)
https://www.europe1.fr/societe/1848-atteintes-a-la-laicite-a-lecole-entre-septembre-et-decembre-2024-305298 - Article – “Éducation nationale : 1 848 atteintes à la laïcité recensées à l’école…” (CNews)
https://www.cnews.fr/france/2025-02-12/education-nationale-1848-atteintes-la-laicite-recensees-lecole-entre-septembre-et - Article – “Les atteintes à la laïcité à l’école en baisse entre septembre et décembre 2024” (Le Figaro)
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-atteintes-a-la-laicite-a-l-ecole-en-baisse-entre-septembre-et-decembre-2024-20250212 - Éducation aux médias – CLEMI
https://www.clemi.fr
Influenceurs religieux et réseaux sociaux
- Frères musulmans : “TikTok est devenu le concurrent direct de l’Éducation nationale” – L’Express
https://www.lexpress.fr/societe/influence-des-freres-musulmans-en-france-tiktok-est-devenu-le-concurrent-direct-de-leducation-NS - TikTok : enquête sur ces influenceurs islamistes qui envahissent la plateforme – L’Express
https://www.lexpress.fr/societe/tiktok-enquete-sur-ces-influenceurs-islamistes-qui-envahissent-la-plateforme-V6Y5V5TF6RAT7OSVQBC - “Frères musulmans : comment les islamistes ont phagocyté TikTok pour embrigader la jeunesse” – Europe 1
https://www.europe1.fr/societe/freres-musulmans-comment-les-islamistes-ont-phagocyte-tiktok-pour-embrigader-la-jeunesse-753602 - “De YouTube à TikTok, ces influenceurs musulmans qui prêchent l’islam intégral et branché” – Le Figaro
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/de-youtube-a-tiktok-ces-influenceurs-musulmans-qui-prechent-l-islam-integral-et-branche-20220904 - “De la propagande islamiste à destination de la jeunesse : TikTok dans le viseur d’un rapport du ministère de l’Intérieur” – CNews
https://www.cnews.fr/france/2025-05-20/de-la-propagande-islamiste-destination-de-la-jeunesse-tiktok-dans-le-viseur-dun - “Sur TikTok, le boom des influenceurs islamistes” – Valeurs actuelles
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/sur-tiktok-le-boom-des-influenceurs-islamistes - “Comment les islamistes se sont emparés de TikTok pour embrigader la jeunesse” – Le Figaro
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ma-soeur-pour-etre-belle-il-faut-juste-se-couvrir-comment-les-islamistes-se-sont-empares-de-tiktok-pour-embrigader-la-jeunesse-20250520
Influenceurs chrétiens
- “15 influenceurs chrétiens sur Instagram, TikTok et YouTube”
https://buzzvoice.com/blog/fr/top-des-influenceurs-chretiens/ - “30 influenceurs chrétiens qui inspirent des millions de personnes”
https://www.clickanalytic.com/fr/find-influencers/worldwide/christian-influencers/ - Reportage – “Le grand boom des influenceurs chrétiens” – RTS
https://www.rts.ch
Miviludes, dérives sectaires, crudivorisme et New Age
- Rapports d’activité de la Miviludes (page officielle)
https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/nos-ressources/nos-publications/rapports-dactivite-de-miviludes - Rapport d’activité 2021–2024 (PDF)
https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/MIVILUDES-RAPPORT2021_web_%2005_03_2025%20.pdf - “Rapport d’activité 2022–2024 de la Miviludes : des signalements en hausse” – Pratiques en santé
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/bilan-13/rapport-d-activite-2022-2024-de-la-miviludes-des-signalements-en-hausse-4677 - “Jeûne extrême, crudivorisme… Les pratiques sectaires santé et bien-être en forte augmentation” – Ouest-France
https://www.ouest-france.fr/societe/crudivorisme-jeune-extreme-les-pratiques-sectaires-sante-et-bien-etre-en-forte-augmentation - “Dérive sectaire en santé et bien-être : l’expertise de la Miviludes de plus en plus sollicitée” – Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
https://www.ordremk.fr/actualites/kines/derive-sectaire-en-sante-et-bien-etre-lexpertise-de-la-miviludes-de-plus-en-plus-sollicitee - Fiche “Le Nouvel Âge ou New Age” – GEMPI
https://www.gemppi.org/sectes-et-mouvances/profils-holistiques-new-age/le-nouvel-age-ou-new-age/ - New Age – Notice générale
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age - “Dérives sectaires : les classes supérieures ont un faux sentiment de sécurité” – Marianne
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/derives-sectaires-les-classes-superieures-ont-un-faux-sentiment-de-securite